Cyberattaques dans l’agroalimentaire : Une menace sous-estimée ?
Longtemps perçue comme un sujet réservé aux secteurs stratégiques comme la défense ou la finance, la cybersécurité s’impose désormais comme une préoccupation majeure pour l’ensemble des filières industrielles. L’agroalimentaire, premier secteur industriel français en termes d’emplois et de chiffre d’affaires, pourrait ne plus échapper à cette tendance. En effet, entre numérisation croissante des processus de production, interconnexion des systèmes, …

Longtemps perçue comme un sujet réservé aux secteurs stratégiques comme la défense ou la finance, la cybersécurité s’impose désormais comme une préoccupation majeure pour l’ensemble des filières industrielles. L’agroalimentaire, premier secteur industriel français en termes d’emplois et de chiffre d’affaires, pourrait ne plus échapper à cette tendance. En effet, entre numérisation croissante des processus de production, interconnexion des systèmes, développement de l’agriculture de précision, télémaintenance ou encore traçabilité en temps réel, l’exposition aux cybermenaces s’est amplifiée.
Si les attaques contre les grands groupes industriels font parfois la une de l’actualité, les entreprises agroalimentaires, y compris les PME et ETI, sont aujourd’hui pleinement concernées. Et pour cause : chaînes de froid, systèmes de supervision (SCADA), logiciels ERP, automates de production, capteurs connectés… tous ces outils critiques peuvent devenir les portes d’entrée d’une attaque ciblée, paralysant tout ou partie de l’activité.
C’est dans ce contexte que, dans le cadre de France 2030, une nouvelle vague d’appels à projets vise à renforcer les briques technologiques critiques de cybersécurité, avec un accent particulier mis sur l’évaluation de la sécurité des systèmes, des processus et des compétences humaines. L’enjeu est double : préserver la souveraineté numérique de la France, et protéger des secteurs essentiels à la vie économique et sociale, comme l’agroalimentaire.
La question n’est plus de savoir si les acteurs du secteur agroalimentaire doivent s’intéresser à la cybersécurité, mais comment ils peuvent la prendre à bras-le-corps.
L’agroalimentaire, une cible de choix
L’idée que l’agroalimentaire serait un secteur « à l’abri » des cyberattaques a longtemps prévalu. En comparaison des banques, des hôpitaux ou des services publics, l’industrie alimentaire a pu sembler moins attractive aux yeux des cybercriminels. Pourtant, cette perception est aujourd’hui dépassée. En réalité, le secteur cumule plusieurs caractéristiques qui en font une cible de choix : systèmes techniques complexes mais souvent mal protégés, infrastructures critiques sensibles aux arrêts de production, et faible culture de la cybersécurité dans de nombreuses entreprises, notamment les PME.
Les cyberattaques visant l’agroalimentaire ne relèvent plus de la fiction. En 2021, le géant américain JBS, premier producteur mondial de viande, a vu ses opérations suspendues dans plusieurs pays suite à une attaque par ransomware. La rançon exigée s’élevait à 11 millions de dollars. En France, le groupe Lactalis a été victime d’une cyberattaque en 2022, entraînant des perturbations dans ses activités. D’autres entreprises, plus discrètes, subissent des intrusions, parfois sans même s’en rendre compte, ou choisissent de ne pas les rendre publiques pour éviter toute perte de confiance.
Ces incidents ne sont pas anecdotiques. Selon l’ANSSI, le secteur industriel représentait 20 % des victimes d’attaques signalées en 2022. Parmi elles, l’agroalimentaire figure désormais dans le radar des cybercriminels. Plusieurs facteurs l’expliquent : le recours croissant à l’automatisation, l’essor de l’Internet des objets (IoT), la connectivité croissante entre équipements de production, logiciels de gestion et plateformes externes. À cela s’ajoute la forte dépendance à la continuité d’activité : une simple interruption d’un outil de supervision peut bloquer une ligne entière de production, engendrant des pertes économiques majeures.
Des vulnérabilités souvent ignorées
Nombre d’entreprises agroalimentaires disposent d’installations techniques anciennes, peu préparées aux risques numériques. Les automates programmables industriels (API), qui pilotent les lignes de fabrication, sont rarement conçus avec la cybersécurité à l’esprit. Les mises à jour sont parfois absentes, les accès distants mal sécurisés, et les mots de passe d’usine jamais changés. À cela s’ajoute la généralisation du télétravail, initiée pendant la crise sanitaire, qui a parfois introduit des failles en connectant des postes personnels non sécurisés aux réseaux internes.
Par ailleurs, la méconnaissance des risques numériques reste répandue dans le secteur. La cybersécurité est encore souvent perçue comme une problématique exclusivement informatique, reléguée au service IT, alors qu’elle concerne l’ensemble des métiers, de la direction industrielle au service qualité, en passant par la logistique. Une attaque par ransomware ne bloque pas seulement des fichiers : elle peut geler les stocks, interrompre le conditionnement, stopper les flux de distribution et mettre en péril des denrées périssables.
Outre les pertes économiques directes liées à une paralysie de la production, une cyberattaque peut avoir des effets collatéraux majeurs : erreurs de dosage, dysfonctionnement des capteurs de température, falsification des données de traçabilité ou des dates de péremption, voire sabotage ciblé. Les risques pour la sécurité alimentaire deviennent alors bien réels.
Dans une industrie soumise à des exigences strictes de conformité, ces perturbations peuvent également se traduire par des sanctions réglementaires, un rappel de lots, voire une perte durable de réputation. Pour une entreprise de taille moyenne, l’enjeu peut être vital. D’après une étude menée par la CPME, 60 % des PME victimes d’une cyberattaque grave cessent leur activité dans les six mois.
Quels défis pour renforcer la cybersécurité dans l’agroalimentaire ?
Si les cybermenaces sont désormais reconnues comme un risque réel pour l’agroalimentaire, les réponses apportées par le secteur restent encore inégales. De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes structures, peinent à structurer une démarche de cybersécurité à la hauteur des enjeux. Par manque de moyens, de compétences internes, mais aussi par absence de vision claire sur ce qui doit être protégé, comment et avec quelles priorités. La montée en puissance des exigences réglementaires, des appels à projets publics et des normes sectorielles vient cependant encourager le mouvement.
L’un des premiers défis tient à l’architecture même des sites agroalimentaires. Les infrastructures informatiques de production (systèmes SCADA, MES, ERP, capteurs, automates) cohabitent avec des réseaux bureautiques classiques, le tout formant un environnement souvent mal cloisonné, au sein duquel une simple brèche peut avoir des effets en cascade. Beaucoup d’équipements n’ont pas été conçus pour résister à des intrusions numériques. Les anciennes générations d’automates ne permettent ni chiffrement, ni authentification forte, et certaines machines utilisent encore des protocoles non sécurisés.
À cela s’ajoute l’interface grandissante entre informatique et production : capteurs connectés, supervision à distance, maintenance prédictive, pilotage cloud… Ces usages augmentent l’exposition aux cyberrisques. Or, segmenter les réseaux OT (technologies opérationnelles) et IT (technologies de l’information) reste une tâche complexe, surtout dans des usines en fonctionnement continu.
Pour beaucoup d’entreprises, notamment dans les filières agroalimentaires de proximité, la cybersécurité apparaît encore comme une charge plutôt qu’un investissement. Les budgets dédiés sont restreints, les équipes informatiques souvent réduites à une ou deux personnes polyvalentes, parfois externalisées. Le recrutement d’un RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information) à temps plein est rare, et les actions de sensibilisation auprès des collaborateurs encore embryonnaires.
La formation reste un enjeu crucial. L’ANSSI comme le Campus Cyber insistent sur l’urgence de développer une culture commune de la cybersécurité, qui dépasse le seul service informatique. En production, un employé qui branche une clé USB inconnue sur un port machine peut, sans le savoir, compromettre tout un site. À l’échelle managériale, la méconnaissance des conséquences économiques d’une cyberattaque freine encore la prise de décision stratégique.
Une réglementation en évolution, mais mal connue
Le cadre juridique autour de la cybersécurité s’est considérablement densifié ces dernières années, sous l’impulsion de l’Union européenne. Le règlement NIS 2, qui entre en application en 2024, impose à de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire (celles considérées comme « entités essentielles ou importantes ») des obligations accrues en matière de cybersécurité : gestion des risques, détection des incidents, notification aux autorités compétentes, audits de sécurité…
Ces exigences viennent s’ajouter aux contraintes de traçabilité, de qualité sanitaire, de continuité d’activité. Si certains groupes structurés ont entamé une mise en conformité, une grande majorité de PME n’en ont pas encore pris la mesure. Or, ne pas s’y préparer, c’est risquer des sanctions financières en cas de manquement, voire une interdiction d’accès à certains marchés.
Le gouvernement français accompagne cette transition, notamment à travers les appels à projets du plan France 2030. Ceux-ci visent à soutenir l’émergence de briques technologiques critiques, mais aussi à aider les industriels à intégrer la cybersécurité dès la conception de leurs produits ou de leurs infrastructures. La dernière vague en date, centrée sur l’évaluation de cybersécurité, cherche à développer des outils permettant d’analyser la robustesse de l’ensemble des couches numériques d’un système, des composants aux usages.
La gestion des fournisseurs et des chaînes de valeur
Autre difficulté : l’imbrication croissante des chaînes de valeur. Une entreprise agroalimentaire dépend de multiples prestataires, fournisseurs, transporteurs, services logistiques ou plateformes numériques. Or, une cyberattaque peut aussi venir de là. En 2021, la faille de sécurité du logiciel K. a permis à des cybercriminels de pénétrer des milliers de systèmes à travers le monde via un fournisseur de services informatiques.
Dans l’agroalimentaire, cette dépendance aux tiers est d’autant plus critique qu’elle concerne des flux physiques et numériques conjoints. Un ERP piraté chez un fournisseur peut faire tomber en panne un système de commande automatique, retarder des livraisons, bloquer l’édition de documents sanitaires. La sécurité de l’entreprise ne peut plus se penser de façon isolée, mais dans une logique de filière.
Cybersécurité agroalimentaire : comment passer à l’action ?
Face à des menaces protéiformes, à une réglementation renforcée et à une pression croissante sur la continuité d’activité, les entreprises agroalimentaires n’ont plus le luxe de l’attentisme. Des leviers existent pour renforcer leur cybersécurité, même avec des moyens limités. Cela suppose une approche pragmatique, graduée, mais résolument proactive, dans laquelle la sensibilisation, la coopération filière et l’investissement dans des outils adaptés jouent un rôle clé.
Premier axe de transformation : intégrer la cybersécurité à la gouvernance d’entreprise. Il ne s’agit plus de la cantonner au service informatique, mais de la considérer comme un enjeu stratégique de gestion des risques, à l’instar de la qualité ou de la sécurité sanitaire. Cela implique de nommer un référent cybersécurité, même à temps partiel ou mutualisé, chargé de piloter les actions de prévention, de conformité et de réponse aux incidents.
Dans les PME, cette gouvernance peut être soutenue par des structures collectives : pôles agroalimentaires régionaux, clusters, coopératives, syndicats professionnels. Ces acteurs jouent un rôle décisif pour partager les bonnes pratiques, mutualiser les ressources et faciliter l’accès à des expertises. La montée en puissance de programmes d’accompagnement comme ceux du Campus Cyber, de l’ANSSI ou de Bpifrance s’inscrit dans cette logique.
Déployer des mesures techniques prioritaires
Face à l’ampleur des besoins, les entreprises doivent hiérarchiser les actions. L’objectif n’est pas d’atteindre immédiatement un niveau maximal de sécurité, mais de mettre en œuvre les mesures les plus critiques. L’ANSSI recommande ainsi de commencer par dix actions prioritaires, qui constituent le socle minimal d’une protection efficace : mises à jour régulières, gestion rigoureuse des mots de passe, sauvegardes hors-ligne, cloisonnement des réseaux, antivirus, filtrage des connexions, supervision des journaux, gestion des comptes à privilèges, sensibilisation des utilisateurs et politique de sécurité formalisée.
Sur le terrain, ces mesures passent par des gestes simples mais encore trop souvent négligés : supprimer les accès inutiles aux automates industriels, éviter les connexions distantes non sécurisées, bloquer l’usage de périphériques USB non contrôlés, s’assurer que les interfaces entre réseaux bureautique et industriel sont bien segmentées.
Des solutions plus avancées peuvent ensuite être déployées selon les moyens : systèmes de détection d’intrusion (IDS), sécurité des API, simulation de phishing pour tester la vigilance des équipes, audits techniques réguliers, outils de sécurité managés proposés par des prestataires spécialisés, etc.
L’erreur humaine reste l’un des premiers vecteurs d’intrusion. Dans le secteur agroalimentaire, où les équipes sont souvent mixtes (personnel de production, intérimaires, services administratifs), il est crucial de construire une culture commune de la cybersécurité. Cela passe par des formations adaptées, des campagnes de sensibilisation, mais aussi par l’intégration de la dimension cybersécurité dans les procédures internes.
Une alerte lancée rapidement par un opérateur peut permettre de contenir un incident. À l’inverse, un comportement malveillant non repéré peut mettre à terre toute la chaîne de production. Cultiver la vigilance et la responsabilité numérique de chacun est donc un facteur clé de résilience.
S’inscrire dans une logique d’amélioration continue
La cybersécurité n’est pas une démarche figée. Elle repose sur l’anticipation, la capacité à réagir rapidement en cas d’attaque, et l’adaptation constante aux nouvelles menaces. Pour cela, les entreprises doivent s’outiller : plans de réponse à incident, revues de vulnérabilité, tests de résilience, simulateurs de crise.
Elles doivent aussi s’informer sur les signaux faibles du secteur : nouvelles menaces identifiées, vulnérabilités sur les logiciels utilisés, campagnes de phishing en cours, failles matérielles, etc. Des bulletins de veille sont proposés par l’ANSSI, le CERT-FR ou les CSIRT régionaux. S’abonner à ces sources permet d’anticiper et d’ajuster ses protections. Les plus matures pourront aller plus loin, en se dotant de certifications (ISO 27001, cybersécurité NIS 2), en intégrant des clauses cyber dans leurs relations fournisseurs ou en réalisant des audits croisés avec leurs partenaires industriels.
Enfin, les enjeux de cybersécurité ne se résolvent pas uniquement à l’échelle des entreprises. Ils relèvent aussi d’une responsabilité collective, nationale et européenne. Le plan France 2030, à travers ses appels à projets, vise justement à structurer une filière française de cybersécurité solide et innovante.
L’agroalimentaire a un rôle à jouer dans cette dynamique. En tant que secteur stratégique, il est concerné par la souveraineté numérique : capacité à maintenir ses chaînes de valeur face aux cybermenaces, indépendance vis-à-vis de solutions étrangères peu transparentes, participation à la consolidation d’un écosystème local de confiance. Des synergies sont possibles entre industriels, éditeurs de solutions, start-up cyber, laboratoires de recherche. À terme, cela peut donner naissance à des outils spécifiquement adaptés aux contraintes de l’agroalimentaire : cybersécurité embarquée dans les automates, outils de supervision sécurisés pour l’IoT alimentaire, plateformes de simulation de crise pour les acteurs de la chaîne du froid, etc.

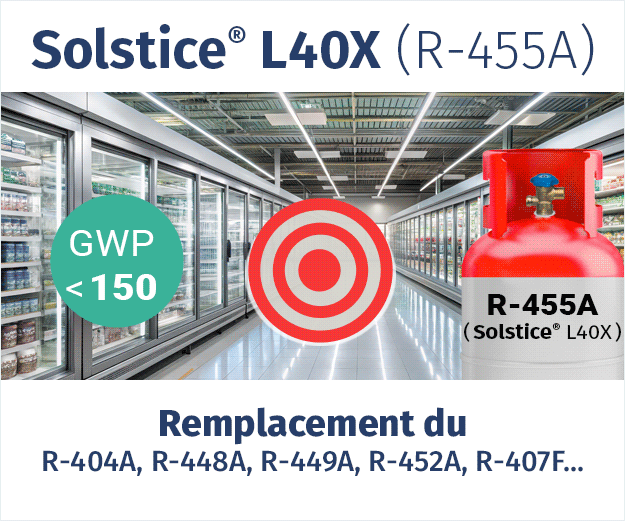
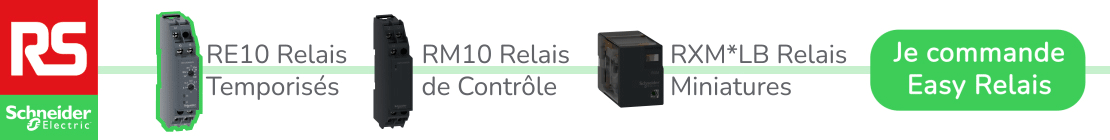




















Connectez-vous avec vos réseaux sociaux :