Les phtalates : un des chantiers prioritaires des parlementaires dès l’été 2012.
D'après une étude menée par l'Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail, l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le Laboratoire d'étude des résidus de contaminants dans les aliments et publiée en mars dernier sur le site Human Reproduction, les phtalates agiraient sur la production de testostérone chez l'homme.

D’après une étude menée par l’Institut de recherche sur la santé, l’environnement et le travail, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le Laboratoire d’étude des résidus de contaminants dans les aliments et publiée en mars dernier sur le site Human Reproduction, les phtalates agiraient sur la production de testostérone chez l’homme. Si ces substances chimiques sont omniprésentes dans notre environnement quotidien, on les retrouve également dans plusieurs produits issus de l’industrie agroalimentaire tels que les emballages plastiques, les canettes pour boisson ou encore les boîtes de conserve. L’analyse des scientifiques français représente une nouvelle avancée de la recherche sur ces perturbateurs endocriniens et démontre la nécessité de renforcer la législation les concernant.
Bien que le lancement de l’initiative REACH qui recense les substances chimiques jugées extrêmement préoccupantes par Bruxelles et qui prévoit notamment l’interdiction des phtalates DEHP, BBP, DBP et DIBP traduit la volonté de lutter contre la généralisation des perturbateurs endocriniens, les efforts réalisés à l’échelle européenne et dans l’Hexagone restent insuffisants au regard des dangers auxquels sont exposés les consommateurs. Tout comme pour le Bisphénol A (BPA), l’utilisation de phtalates est prohibée dans la fabrication de jouets et d’articles de puériculture dans toute l’Union européenne. En mai 2011, les députés français allaient plus loin et adoptaient la proposition de loi émise par Yvan Lachaud, élu du Gard Nouveau Centre (NC) qui demandait l’ « interdiction de la fabrication, de l’importation, de la vente ou de l’offre de produits contenant des phtalates, des parabènes et des alkylphénois ».
Envoyée au Sénat, la proposition Lachaud est toujours en première lecture à la chambre haute. Quels que soient les résultats des scrutins législatifs des 10 et 17 juin prochains, l’examen de ce texte doit devenir l’un des chantiers prioritaires des sénateurs qui ont tout intérêt à suivre l’élan impulsé il y a un an par les députés du Palais Bourbon. L’urgence est d’autant plus pressente que les résultats obtenus par la communauté scientifique depuis plus de dix ans démontrent les conséquences des phtalates sur le développement hormonal chez l’Homme.
Renforcer la législation encadrant l’utilisation des phtalates
Déjà à la fin des années 1990, des chercheurs découvraient que ces substances chimiques inhibaient la production de testostérone effectuées par les testicules chez les rongeurs, entrainant l’apparition d’anomalies au sein de l’appareil génital telle qu’une diminution de la production de spermatozoïdes. Considérés comme des anti-androgènes capables de troubler le développement de l’appareil génital masculin, les phtalates sont aussi au cœur des travaux menés par la professeure du département de médecine préventive de la faculté de Mount Sinai (New-York), Shanna Swan. En 2000, elle étudie des urines de femmes enceintes exposées aux phtalates et met en évidence la corrélation entre la présence de ces substances dans un environnement donné et le développement d’anomalies génitales chez les nourrissons. Plus tard, elle prouve la féminisation de garçons exposés in utero.
À ces observations pour le moins inquiétantes, s’ajoutent celles des chercheurs français qui ont constaté des perturbations hormonales chez des ouvriers exposés aux phtalates dans leur milieu professionnel. En étudiant des testicules en culture qui avaient reçu la même dose de produits chimiques que ces travailleurs, ils ont repéré une diminution de la production de testostérone. Une découverte qui ne doit pas être ignorée alors que la croissance de l’infertilité masculine inquiète l’Europe. Et l’industrie agroalimentaire est particulièrement concernée : en 2010, le documentaire « L’Emballage qui tue » diffusé sur Arte revenait sur les risques encourus pour les consommateurs. Le maïs par exemple, serait contaminé par les phtalates présents dans la résine epoxy qui recouvre l’intérieur des boîtes de conserve. La différence de températures, qui serait provoquée lorsque le maïs est versé dans la boîte encore chaud, entraînerait un dégagement des particules chimiques qui migreraient ainsi vers les aliments.
La loi Lachaud doit toutefois être considérée avec précaution. Les professionnels de l’agroalimentaire, de la chimie et du conditionnement ont prévenu qu’aucun produit de substitution ne pouvait remplacer les phtalates et ont ajouté qu’ils avaient besoin de temps pour diriger de nouvelles recherches. L’Agence nationale de sécurité sanitaire a de son côté rappelé que les substituts fabriqués à la hâte pouvaient eux aussi se révéler dangereux. Nul doute que ces alternatives devront être analysées consciencieusement avant que ne soit lancée leur commercialisation. Certains députés ont en outre précisé qu’une loi ciblant des phtalates en particulier, comme le DEHP, était plus efficace qu’un texte englobant tous ces produits chimiques et qui serait en définitive compliqué à appliquer. Face à autant d’obstacles, les parlementaires doivent s’atteler à un renforcement de la législation pour qu’elle serve l’intérêt des consommateurs. Raison de plus pour relancer rapidement le débat.
Ecrit par : Anna Demontis.

Dans le cadre de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la France s’est fixé comme objectifs de …

Dans le cadre de ses engagements en faveur d’emballages circulaires, Mars Wrigley France lance un projet pilote d’éco-conception de son pochon M&M’s Choco …
RFID, cartons pliants et automatisation : Trois leviers stratégiques pour l’avenir de l’étiquetage et de l’emballage agroalimentaire
Le secteur de l’étiquetage et de l’emballage est en pleine mutation. Pression réglementaire accrue, montée en puissance de la durabilité, nécessité d’innover sans …
Labelexpo Europe 2025 : Anticiper les évolutions de marché et découvrir les dernières innovations
Dès le 16 septembre, Barcelone deviendra la capitale mondiale de l’étiquette et de l’emballage avec Labelexpo Europe, un rendez-vous qui attire chaque édition plus …
Style de vie et santé : Quand les nouvelles habitudes de consommation redessinent l’avenir des boissons
À l’occasion de drinktec, salon de référence pour le secteur des boissons et des aliments liquides, un thème central émerge avec force : « Style …

La rentrée 2025 s’ouvre sur un paradoxe bien connu mais toujours plus marqué : d’un côté, une inflation alimentaire encore présente, qui continue …

Longtemps perçue comme un sujet réservé aux secteurs stratégiques comme la défense ou la finance, la cybersécurité s’impose désormais comme une préoccupation majeure …
Produits aquatiques : Un attrait confirmé, mais un positionnement de plus en plus complexe pour le marché français
Malgré une excellente image auprès des consommateurs français, la consommation de poissons, coquillages et crustacés révèle un arbitrage économique plus marqué qu’auparavant. L’enquête …
Marché du miel en France : Entre regain de confiance, guerre des prix et bataille pour la traçabilité
Après des années de crise, la filière apicole française reprend lentement des couleurs. Les Français consomment toujours du miel, mais deviennent plus sélectifs, …
Mieux sécuriser votre production en optimisant la traçabilité alimentaire
La chaîne agroalimentaire doit aujourd’hui garantir aux consommateurs une alimentation sûre, conforme et transparente, de la fourche à la fourchette. Dans ce contexte, …
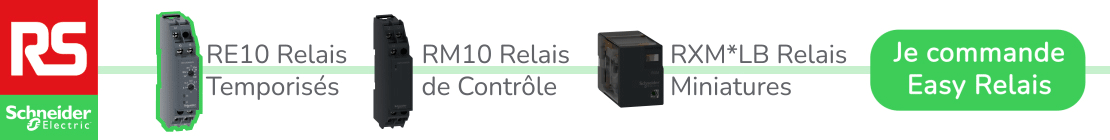
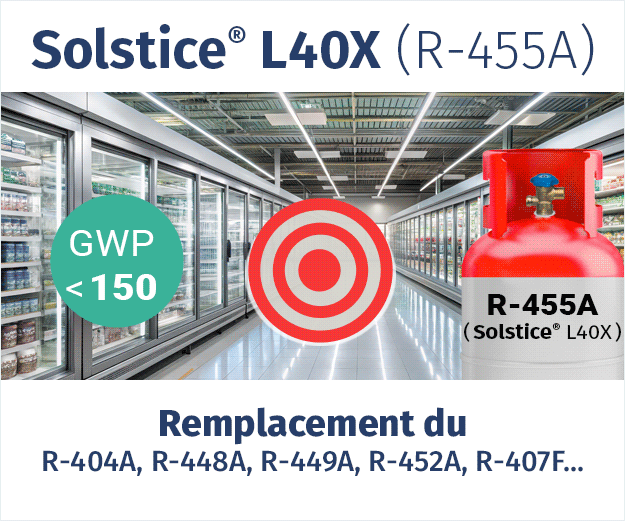

















Connectez-vous avec vos réseaux sociaux :